2013
La campagne 2013 a permis d’établir une séquence chronologique des sites sélectionnés pour le quadriennal. Il est remarquable que les sites de Murgi, Tirisa mais aussi Deskit présentent tous des séquences culturelles longues. Jusqu’à la campagne 2013 seuls les pétroglyphes attestaient d’une présence protohistorique : les opérations de prospections élargies, dont géophysiques, ont révélé des occupations préhistoriques, protohistoriques et historiques aux alentours de certains sites rupestres.
Parmi les apports de la mission 2013, le site lithique de Tirisa est certainement l’un des plus importants. Ce site constitue, pour l’heure, le seul témoin solide pour évoquer la présence et l’installation, certainement temporaire, des hommes à plus de 3000 m d’altitude dans la région. Ainsi, cet imposant site de plein air a pu servir de zone refuge du fait de sa configuration géomorphologique (dépression abritant un lac) et la présence d’andésite apte à la taille a probablement justifié le choix du site par les populations pré-historiques.
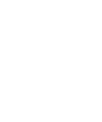
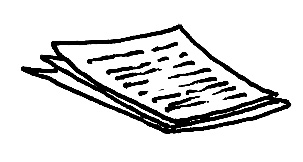 Dépliants informatifs en anglais et en bhoti
Dépliants informatifs en anglais et en bhoti








